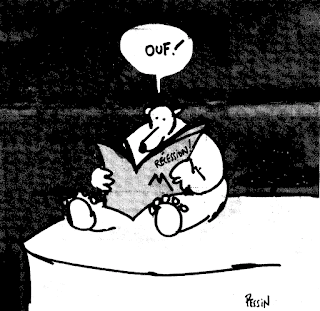La décroissance peut-elle être le but de l’écologie politique ? « Décroissance » est-il le nom d’une notion véritablement politique ? Il importe de clarifier notre rapport à cette notion pour savoir s'il est légitime de lui faire porter les espoirs de l'écologie politique.
L’idée de décroissance s’impose à quiconque essaie de penser les moyens de surmonter l’impasse planétaire que constitue la mainmise des intérêts marchands sur le devenir de notre société désormais mondialisée.
Par exemple, le Global Footprint Network, a calculé que le 8 août est le jour du dépassement, c’est-à-dire le jour de cette année (2016) où l’on a consommé toutes les ressources naturelles que la Terre est capable de produire en un an. Depuis 1986, première année où on a pris, annuellement, plus à la biosphère que ce qu’elle donne, ce jour de dépassement intervient toujours plus tôt. Nous sommes donc aujourd’hui dans un processus de creusement d’un déficit global des échanges de l’espèce humaine avec la biosphère – qui en fait n’est possible qu’en pillant ses réserves – qui condamne sûrement l’avenir, au moins celui de l’espèce humaine. Ce processus est imputable à la croissance.
On appelle alors « croissance » la mesure objective de l’activisme frénétique sur leur environnement des populations humaines sous le régime de la mercatocratie – pouvoir du marchand par le règne du marché et de la marchandise. La logique mercatocratique du rapport à l’environnement est en effet une logique productiviste : il s’agit de transformer toujours plus et toujours plus profondément l’environnement naturel de façon à grossir, multiplier et accélérer indéfiniment les flux de biens marchands par lesquels se réalisent les profits de la minorité affairiste.
La croissance est alors précisément la croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) de chaque pays, autrement dit le chiffre monétaire qui donne la somme de toutes les valeurs d’échange ajoutées en une année par les activités des entreprises situées sur le territoire du pays. Voici ce que cela donne aujourd’hui pour les 10 pays les plus riches du point de vue marchand (source : FMI. Les chiffres de 2016 sont des estimations) :
Rang
|
Pays
|
PIB 2016 (milliards $)
|
PIB 2015 (milliards $)
|
Évolution
|
1
|
États-Unis
|
18 698
|
17 968
|
+4%
|
2
|
Chine
|
12 254
|
11 385
|
+8%
|
3
|
Japon
|
4 171
|
4 116
|
+1%
|
4
|
Allemagne
|
3 473
|
3 371
|
+3%
|
5
|
Royaume-Uni
|
3 055
|
2 865
|
+7%
|
6
|
France
|
2 488
|
2 423
|
+3%
|
7
|
Inde
|
2 385
|
2 183
|
+9%
|
8
|
Italie
|
1 868
|
1 819
|
+3%
|
9
|
Brésil
|
1 673
|
1 800
|
-7%
|
10
|
Canada
|
1 592
|
1 573
|
+1%
|
Les chiffres de la dernière colonne mesurent cette fameuse croissance – ou décroissance quand il est négatif, comme ici pour le Brésil – qui est la valeur par excellence de l’économie telle qu’elle est pensée dans le cadre idéologique du libéralisme marchand.
Étant donné que les choix de comportement économique de chacun – quels biens sont produits, la manière dont on les produit, comment on les fait circuler, comment on se les approprie, comment on s’en sépare, etc. – se font massivement selon les prescriptions de l’économie libérale marchande, il est manifeste que c’est cette valeur économique de croissance qui règne sur les consciences de par le monde. Dès lors un pays en décroissance (comme le Brésil ici) est considéré comme un infortuné pays, celui qui a échoué, qui ne sait pas résoudre ses problèmes, et qui est à secourir, moyennant la punition d’une cure d’austérité pour sa population – car le marché ne saurait s’accommoder de ce facteur de rétrécissement que constitue un territoire où soient freinés les flux de marchandises.
Replacée ainsi dans son contexte, la pensée de la décroissance comme porteuse d’avenir, apparaît indubitablement comme une pensée provocatrice du point de vue des idées dominantes dans la société, car elle est négatrice de l’ordre des choses en lequel chacun essaie d’insérer sa vie.
Il importe donc de reconnaître le caractère foncièrement ambivalent de l’idée de décroissance. Elle est à la fois la voie incontournable du salut d’une société dans l’impasse, et le nom de l’échec d’une société tendue vers sa réussite dans la compétition économique mondiale. Mais il ne faut pas se contenter de concrétiser cette ambivalence par le partage de la population en deux groupes d’orientation idéologique opposée : les forcenés de la croissance et les sages décroissants. La réalité est plus complexe. À examiner précisément les choses, il semble bien que cette ambivalence de la décroissance passe ordinairement à l’intérieur des individus. Le jour, en tant qu’actif inséré dans la société, on peut faire assidûment des choix, de consommation et de production, pour la croissance, et le soir, mettant un peu de perspective dans son existence, soupirer en pensant que le monde irait bien mieux s’il s’orientait vers la décroissance. Il n’y a rien d’étonnant à cela. Les humains essaient de vivre, et comme ils sont faits pour vivre en société, ils s’investissent dans la société telle qu’on la leur offre, c’est-à-dire une société d’économie marchande de compétition et de croissance. Mais comme ils restent biologiquement humains, ils ne peuvent que se penser continuer à vivre, eux-mêmes et leur lignée, dans un monde en lequel ils se sentent humainement bien, c’est-à-dire de beauté vivante.
Les humains de la société toute marchande sont incohérents, certes ! Mais qu’ils soient amenés à cette scission d’avec eux-mêmes, à cette sorte de schizophrénie commune, n’est-il pas l’indice que la mercatocratie est un pouvoir totalitaire ? N’est-ce pas le propre d’un pouvoir totalitaire de s’immiscer dans la conscience de chacun pour imposer une vision du monde commune et forcément optimiste – ici (en mercatocratie) la réussite de sa vie, le bonheur, comme sommation de sensations positives apportées par la consommation de biens marchands ? Or, comme un pouvoir totalitaire n’annulera jamais totalement l’expérience populaire immanente, et les mots propres (ceux du peuple) pour la dire, les individus secrètent une autre vision du monde, celle de leur expérience commune – pourquoi tant de déchets, de gaspillage, de ravages, de laideur, de difficultés à vivre humainement ? Ces deux visions du monde s’excluant mutuellement entraînent cette sorte de schizophrénie commune par laquelle, en chacun, cohabite le croissant et le décroissant. La prendre en compte permet de mieux comprendre la difficulté qu’il peut y avoir à faire de la décroissance un emblème pour l’action politique.
Car, oserions-nous dire, il n’est pas possible d’être décroissant sereinement. S’affirmer pour la décroissance est sûrement une provocation à l’endroit d’une société qui met la valeur d’échange – l’argent – au pinacle des valeurs ; mais, plus profondément, c’est une provocation à l égard de soi-même, je veux dire cette part de soi-même qui aspirait à la plus grosse part du gâteau à la tablée familiale, au plus gros sac de billes dans la cour de récréation, etc. Hé oui ! Si la croissance nous embrigade si bien dans son mirage, c’est qu’elle résonne fortement dans notre imaginaire : nous avons tous commencé par être croissants. Et n’est-il pas naturel que la « croissance » (les guillemets pour dire que nous retrouvons le sens premier, le sens large) ait été la première version de notre vitalité humaine ? Le problème est bien qu’elle le demeure à l’état adulte. Il faut en effet admettre que la société de croissance – la société mercatocratique mondialisée que nous connaissons – fonctionne sur des principes clairement infantiles : la compétition pour avoir plus (n’est-ce pas un mode de relation très commun entre bambins dans les haltes-garderies ?). Cette infantilité, incessamment flattée en chacun de nous par les messages émanant des intérêts marchands, est un puissant facteur qui rend possible l'actuelle croissance proliférante de la prédation humaine sur la biosphère. Et donc, c’est contre nous-mêmes ainsi flattés de même que contre les flatteurs que nous nous dressons en nous affirmant décroissants.
C’est pourquoi il faut reconnaître que la réponse par la décroissance aux impasses de la société actuelle est une réponse fortement connotée affectivement. Elle est, plus profondément qu’une contestation de l’ordre (chaotique) établi, un règlement de compte de soi à soi. C’est un rejet d’une part de soi qui doit se faire d’autant plus véhémentement que non seulement elle porte nos désirs les plus enfouis, mais que toute l’idéologie ambiante concourt à la conforter.
C’est ainsi qu’on peut expliquer la capacité de l’idée de décroissance à catalyser aujourd’hui les aspirations à une alternative écologiste. Le mot « décroissance » nous parle. Il nous parle socialement puisqu’il opère un renversement des valeurs établies qui sont aussi celles de l’économisme ambiant[1]. Il nous parle intimement puisqu’il nous pose en rupture avec les sollicitations de continuer à vivre indéfiniment selon notre logique infantile. Par l’endossement de ce simple mot « décroissance », l’individu conjure non seulement son enfermement dans le passé (l’infantilité adulte du travailleur-consommateur), mais également son enfermement dans l’avenir (l’épuisement et la mort à terme de la biosphère). Mais le mot « décroissance » n’acquiert cette force réactive que parce qu’il est tiré d’une catégorie essentielle de l’économisme mercatocratique – la « croissance » – dont il est la simple négation. Autrement dit, en s’affirmant « décroissant » on se situe toujours dans la vision mercatocratique du monde même si c’est sur le mode de la négation.
Pour le dire en termes spinozistes, l’idée de décroissance reste une idée réactive qui se comprend plutôt par ce qui nous affecte (la société de production-consommation frénétique) que par ce que nous sommes (nous ne sommes alors que génériquement indistincts en tant qu’humains entravés dans leur désir de vivre).
De cette analyse, il faut tirer la conséquence que fonder un projet politique sur l’idée de décroissance ne peut être que problématique. En effet, un tel projet motive à dire non à beaucoup de choses, mais il n’offre pas d’appui pour dire oui, c’est-à-dire pour construire une société alternative. On pourrait dérouler indéfiniment les prescriptions négatives qu’il peut inspirer : ne pas consommer au-delà de ses besoins vitaux (sobriété) et tendre vers une morale ascétique, ne pas jeter inconsidérément, ne pas travailler (dans le cadre du salariat), renoncer aux échanges d’argent, renoncer à s’insérer dans la société présente, etc.
On remarquera très justement que ces refus impliquent des comportements différents, nouveaux, par rapport aux biens et aux personnes, qui apparaissent autant de positions fondatrices pour une société alternative. Ne pas jeter ce qui ne marche pas pour le remplacer par un nouvel achat implique de s’approprier la connaissance technique de l’objet, des savoir-faire techniques, le sens du bricolage, et donc un nouveau rapport à l’objet, de plus cela ouvre souvent à une coopération non marchande avec autrui.
Mais alors pourquoi toutes ces démarches de refus de l’économie néolibérale de la croissance ne produisent-elles pas une perspective sociale nouvelle, consciente d’elle-même, qui aimante tant de consciences lasses de la course haletante et absurde qu’exige la vie moderne, les amenant à entrer massivement en dissidence ?
Il semble que ce soit dans l’attachement affectif à la notion de décroissance que réside le problème. Il y a un élément de valorisation de soi à s’identifier comme « décroissant » qui est à la mesure de la rupture avec la part de soi-même que l’on abhorre et qui est signifiée par ce mot. Si la démarche de dissidence trouve l’essentiel de sa motivation dans ce bénéfice d’amour-propre lié au mot « décroissance », alors elle n’est pas en situation de s’orienter vers une nouvelle forme de vie sociale qui serait désirée pour elle-même, et non pour ce qu’elle n’est plus. Et la société mercatocratique reste alors, d’une certaine manière, maîtresse du jeu, car la notion de « décroissance » appartenant tout autant que celle de « croissance » à sa vision du monde, elle intègre aisément les « décroissants » comme ses rejetons superflus, sorte de part incompressible des inadaptables à son système social – les « marginaux » – qui finalement confirment la règle ultra-majoritaire de l’adhésion à une société de bien-être par le travail et la consommation. Car on ne saurait attendre de « décroissants », ainsi aliénés au fétichisme du mot, beaucoup plus qu’un imaginaire confus d’une « société sans » (sans surconsommation, gaspillage, pollution, déchets durables, destructions des espèces vivantes, etc.). Et jamais un tel imaginaire ne risquerait d’entraîner les populations de la société de l’abondance des marchandises à entrer en dissidence pour une société alternative.
Comprenons que le point crucial est ici la liberté. C’est bien notre liberté proprement humaine qui s’exprime dans notre promotion de la décroissance : nous refusons notre infantilisation comme travailleur-consommateur, nous revendiquons un autre sens à notre vie. Mais quand cette liberté se complaît dans le bénéfice affectif de son refus en contemplant son audace dans le mot qui la signifie, elle est une liberté inachevée. Elle n’a rien créé comme possibilités nouvelles de vie sociale. Pour ce faire il faudra qu’elle sorte de la subjectivité stérile de l’imaginaire d’une « société sans » pour trouver la voie de la verbalisation avec autrui, du dialogue, afin de parvenir à un discours cohérent établissant un projet commun. Hannah Arendt a montré que nous ne réalisons pleinement notre liberté humaine que dans l’action politique « car l'action et la politique, parmi toutes les capacités et possibilités de la vie humaine, sont les seules choses dont nous ne pourrions même pas avoir l'idée sans présumer au moins que la liberté existe, et nous ne pouvons toucher une seule question politique sans mettre le doigt sur une question où la liberté humaine est en jeu » (La crise de la culture). L’« action », pas la « réaction » ! Et l’action politique requiert le passage de l’émotion collective qui nous fait nous reconnaître affectés de concert par une condition sociale inacceptable, à la réflexion collective qui amène à concevoir au moyen du discours rationnel une autre société possible et souhaitable[2]. Cela signifie que la décroissance n’est pas encore une notion politique et qu’elle est à contre-emploi comme principe d’une démarche politique.
C’est bien ce que paraissent illustrer les essais d’élaboration rationnelle d’une voie vers une société alternative désirable qui sont proposés aujourd’hui et qui se rangent sous le principe de la décroissance comme si cela ne pouvait aller que de soi (voir par exemple les essais de P. Rabhi, S. Latouche, J.-P. Besset, P. Viveret, etc.). Ces penseurs, quoiqu’ils en veuillent (ils font de touchants efforts pour positiver), sont pris dans les filets de l’apriori négatif de leur démarche. Ils sont en effet constamment confrontés au problème des limites. Où placer les limites des transformations humaines de la nature pour créer des biens ? Comment les légitimer ? Comment éviter de faire appel à une instance transcendante reconductrice de croyances ? Comment échapper à l’instauration d’un moralisme écologiste au moins pesant sinon totalitaire ? Ces auteurs résolvent ces problèmes en pariant sur une régulation immanente, c’est-à-dire qui tendrait à se faire d’elle-même par la redécouverte par chacun de ses intérêts proprement humains (donc non infantiles et de caractère non addictif). Ils la cherchent en général à la fois du côté de la récompense par les sentiments – « sobriété heureuse » – et du côté de la sagesse populaire telle qu’elle se manifeste dans les diverses initiatives locales de solutions de vie fondées sur des principes alternatifs (comme en montre le film « Demain ») et qui représenteraient chacune ce que l’on se plaît nommer une « utopie concrète ».
Mais d’« utopie concrète », il n’y aura jamais. C’est une contradiction dans les termes puisque, étymologiquement, « utopie » est la description d’une société idéale qui ne peut exister nulle part. Il y a effectivement des tentatives – il faudrait dire des « créations » – concrètes de vie sociale alternative qui durent et réussissent plus ou moins. Elles sont un puissant espoir, non pas parce qu’elles seraient comme des « utopies »[3] , mais parce que ce sont des « expériences », certes faillibles, mais pour cela toujours riches d’enseignements. La réflexion collective à partir de ces expériences peut effectivement permettre de préciser les contours d’une société alternative souhaitable (c’est là seulement que la notion d’« utopie » peut se justifier), et la voie qui peut y mener. Quant à l’annonce de la joie par la sobriété (« sobriété heureuse »), il faut accepter que l’idiosyncrasie du sage qu’elle préfigure ne soit pas universalisable et que ceux qui contreviendraient ne soient pas socialement dangereux. Rappelons à ce propos les dernières lignes de l’Éthique de Spinoza : « La Béatitude n’est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même ; et nous n’en jouissons pas parce que nous réprimons nos penchants, mais c’est au contraire parce que nous en jouissons, que nous pouvons réprimer nos penchants. »
Ainsi, il apparaît que, dans la théorisation contemporaine d’une société alternative à notre si dévastatrice société mercatocratique, l’apriori accordé à la décroissance amène à une inversion dans l’ordre des raisons. On veut voir le bonheur surgir de la sobriété, alors que ce serait plutôt dans un état social en lequel on serait bien parce qu’il serait conforme à notre humanité qu’on n’aurait plus de raisons de poursuivre indéfiniment à travers des actes de consommation un bien qu’ils ne sauraient apporter. De même on veut voir des « utopies » déjà réalisées et qu’il suffirait de généraliser dans les expériences locales alternatives – « utopie » signifiant alors « îlot de décroissance » –, bien qu’il ne s’agisse que d’essais d’autres principes de vie sociale qui doivent être confrontés, critiqués, élaborés. L’utopie ne saurait venir qu’au bout de cette démarche théorique collective. Et il faut rappeler ici, après les errements des continuateurs de Marx, que l’utopie n’est jamais la description d’une société à concrétiser, mais la clarification du sens à donner à une action politique « révolutionnaire » (au sens propre : qui vise à changer les principes de la vie sociale).
L’enjeu, c’est de nous atteler positivement à une construction de l’avenir. Cela suppose que nous ayons acquis suffisamment de lucidité sur les démons qui ont obéré notre passé – et il n’y a pas que l’infantilité de notre rapport au travail et à la marchandise[4] – pour ne pas nous abîmer dans des règlements de compte avec eux. Nous pouvons nous rattacher aux espoirs et réflexions de nos mères et pères à l’orée de la révolution industrielle quand, se rendant compte des lourds nuages sur l’humanité qu’annonçaient les projets d’instauration du règne de la marchandise et de l’argent par les « bourgeois » nouvellement arrivés au pouvoir, ils s’y sont opposés avec leur corps, dans de nombreux mouvements populaires entre 1789 et 1871, mais aussi avec leur esprit en proposant une logique alternative des rapport sociaux[5].
Aujourd’hui, il nous faut prendre en compte, non seulement l’injustice sociale créée par l'empire de la marchandise, mais la crise écologique aigüe en laquelle il plonge la planète. Une bonne entrée pour une réflexion tirant parti des expériences alternatives locales ne serait-elle pas dans la question : quel sens est-il souhaitable de donner à notre activité de transformation de l’environnement naturel ?
Étant donné que les choix de comportement économique de chacun – quels biens sont produits, la manière dont on les produit, comment on les fait circuler, comment on se les approprie, comment on s’en sépare, etc. – se font massivement selon les prescriptions de l’économie libérale marchande, il est manifeste que c’est cette valeur économique de croissance qui règne sur les consciences de par le monde. Dès lors un pays en décroissance (comme le Brésil ici) est considéré comme un infortuné pays, celui qui a échoué, qui ne sait pas résoudre ses problèmes, et qui est à secourir, moyennant la punition d’une cure d’austérité pour sa population – car le marché ne saurait s’accommoder de ce facteur de rétrécissement que constitue un territoire où soient freinés les flux de marchandises.
Replacée ainsi dans son contexte, la pensée de la décroissance comme porteuse d’avenir, apparaît indubitablement comme une pensée provocatrice du point de vue des idées dominantes dans la société, car elle est négatrice de l’ordre des choses en lequel chacun essaie d’insérer sa vie.
Il importe donc de reconnaître le caractère foncièrement ambivalent de l’idée de décroissance. Elle est à la fois la voie incontournable du salut d’une société dans l’impasse, et le nom de l’échec d’une société tendue vers sa réussite dans la compétition économique mondiale. Mais il ne faut pas se contenter de concrétiser cette ambivalence par le partage de la population en deux groupes d’orientation idéologique opposée : les forcenés de la croissance et les sages décroissants. La réalité est plus complexe. À examiner précisément les choses, il semble bien que cette ambivalence de la décroissance passe ordinairement à l’intérieur des individus. Le jour, en tant qu’actif inséré dans la société, on peut faire assidûment des choix, de consommation et de production, pour la croissance, et le soir, mettant un peu de perspective dans son existence, soupirer en pensant que le monde irait bien mieux s’il s’orientait vers la décroissance. Il n’y a rien d’étonnant à cela. Les humains essaient de vivre, et comme ils sont faits pour vivre en société, ils s’investissent dans la société telle qu’on la leur offre, c’est-à-dire une société d’économie marchande de compétition et de croissance. Mais comme ils restent biologiquement humains, ils ne peuvent que se penser continuer à vivre, eux-mêmes et leur lignée, dans un monde en lequel ils se sentent humainement bien, c’est-à-dire de beauté vivante.
Les humains de la société toute marchande sont incohérents, certes ! Mais qu’ils soient amenés à cette scission d’avec eux-mêmes, à cette sorte de schizophrénie commune, n’est-il pas l’indice que la mercatocratie est un pouvoir totalitaire ? N’est-ce pas le propre d’un pouvoir totalitaire de s’immiscer dans la conscience de chacun pour imposer une vision du monde commune et forcément optimiste – ici (en mercatocratie) la réussite de sa vie, le bonheur, comme sommation de sensations positives apportées par la consommation de biens marchands ? Or, comme un pouvoir totalitaire n’annulera jamais totalement l’expérience populaire immanente, et les mots propres (ceux du peuple) pour la dire, les individus secrètent une autre vision du monde, celle de leur expérience commune – pourquoi tant de déchets, de gaspillage, de ravages, de laideur, de difficultés à vivre humainement ? Ces deux visions du monde s’excluant mutuellement entraînent cette sorte de schizophrénie commune par laquelle, en chacun, cohabite le croissant et le décroissant. La prendre en compte permet de mieux comprendre la difficulté qu’il peut y avoir à faire de la décroissance un emblème pour l’action politique.
Car, oserions-nous dire, il n’est pas possible d’être décroissant sereinement. S’affirmer pour la décroissance est sûrement une provocation à l’endroit d’une société qui met la valeur d’échange – l’argent – au pinacle des valeurs ; mais, plus profondément, c’est une provocation à l égard de soi-même, je veux dire cette part de soi-même qui aspirait à la plus grosse part du gâteau à la tablée familiale, au plus gros sac de billes dans la cour de récréation, etc. Hé oui ! Si la croissance nous embrigade si bien dans son mirage, c’est qu’elle résonne fortement dans notre imaginaire : nous avons tous commencé par être croissants. Et n’est-il pas naturel que la « croissance » (les guillemets pour dire que nous retrouvons le sens premier, le sens large) ait été la première version de notre vitalité humaine ? Le problème est bien qu’elle le demeure à l’état adulte. Il faut en effet admettre que la société de croissance – la société mercatocratique mondialisée que nous connaissons – fonctionne sur des principes clairement infantiles : la compétition pour avoir plus (n’est-ce pas un mode de relation très commun entre bambins dans les haltes-garderies ?). Cette infantilité, incessamment flattée en chacun de nous par les messages émanant des intérêts marchands, est un puissant facteur qui rend possible l'actuelle croissance proliférante de la prédation humaine sur la biosphère. Et donc, c’est contre nous-mêmes ainsi flattés de même que contre les flatteurs que nous nous dressons en nous affirmant décroissants.
C’est pourquoi il faut reconnaître que la réponse par la décroissance aux impasses de la société actuelle est une réponse fortement connotée affectivement. Elle est, plus profondément qu’une contestation de l’ordre (chaotique) établi, un règlement de compte de soi à soi. C’est un rejet d’une part de soi qui doit se faire d’autant plus véhémentement que non seulement elle porte nos désirs les plus enfouis, mais que toute l’idéologie ambiante concourt à la conforter.
C’est ainsi qu’on peut expliquer la capacité de l’idée de décroissance à catalyser aujourd’hui les aspirations à une alternative écologiste. Le mot « décroissance » nous parle. Il nous parle socialement puisqu’il opère un renversement des valeurs établies qui sont aussi celles de l’économisme ambiant[1]. Il nous parle intimement puisqu’il nous pose en rupture avec les sollicitations de continuer à vivre indéfiniment selon notre logique infantile. Par l’endossement de ce simple mot « décroissance », l’individu conjure non seulement son enfermement dans le passé (l’infantilité adulte du travailleur-consommateur), mais également son enfermement dans l’avenir (l’épuisement et la mort à terme de la biosphère). Mais le mot « décroissance » n’acquiert cette force réactive que parce qu’il est tiré d’une catégorie essentielle de l’économisme mercatocratique – la « croissance » – dont il est la simple négation. Autrement dit, en s’affirmant « décroissant » on se situe toujours dans la vision mercatocratique du monde même si c’est sur le mode de la négation.
Pour le dire en termes spinozistes, l’idée de décroissance reste une idée réactive qui se comprend plutôt par ce qui nous affecte (la société de production-consommation frénétique) que par ce que nous sommes (nous ne sommes alors que génériquement indistincts en tant qu’humains entravés dans leur désir de vivre).
De cette analyse, il faut tirer la conséquence que fonder un projet politique sur l’idée de décroissance ne peut être que problématique. En effet, un tel projet motive à dire non à beaucoup de choses, mais il n’offre pas d’appui pour dire oui, c’est-à-dire pour construire une société alternative. On pourrait dérouler indéfiniment les prescriptions négatives qu’il peut inspirer : ne pas consommer au-delà de ses besoins vitaux (sobriété) et tendre vers une morale ascétique, ne pas jeter inconsidérément, ne pas travailler (dans le cadre du salariat), renoncer aux échanges d’argent, renoncer à s’insérer dans la société présente, etc.
On remarquera très justement que ces refus impliquent des comportements différents, nouveaux, par rapport aux biens et aux personnes, qui apparaissent autant de positions fondatrices pour une société alternative. Ne pas jeter ce qui ne marche pas pour le remplacer par un nouvel achat implique de s’approprier la connaissance technique de l’objet, des savoir-faire techniques, le sens du bricolage, et donc un nouveau rapport à l’objet, de plus cela ouvre souvent à une coopération non marchande avec autrui.
Mais alors pourquoi toutes ces démarches de refus de l’économie néolibérale de la croissance ne produisent-elles pas une perspective sociale nouvelle, consciente d’elle-même, qui aimante tant de consciences lasses de la course haletante et absurde qu’exige la vie moderne, les amenant à entrer massivement en dissidence ?
Il semble que ce soit dans l’attachement affectif à la notion de décroissance que réside le problème. Il y a un élément de valorisation de soi à s’identifier comme « décroissant » qui est à la mesure de la rupture avec la part de soi-même que l’on abhorre et qui est signifiée par ce mot. Si la démarche de dissidence trouve l’essentiel de sa motivation dans ce bénéfice d’amour-propre lié au mot « décroissance », alors elle n’est pas en situation de s’orienter vers une nouvelle forme de vie sociale qui serait désirée pour elle-même, et non pour ce qu’elle n’est plus. Et la société mercatocratique reste alors, d’une certaine manière, maîtresse du jeu, car la notion de « décroissance » appartenant tout autant que celle de « croissance » à sa vision du monde, elle intègre aisément les « décroissants » comme ses rejetons superflus, sorte de part incompressible des inadaptables à son système social – les « marginaux » – qui finalement confirment la règle ultra-majoritaire de l’adhésion à une société de bien-être par le travail et la consommation. Car on ne saurait attendre de « décroissants », ainsi aliénés au fétichisme du mot, beaucoup plus qu’un imaginaire confus d’une « société sans » (sans surconsommation, gaspillage, pollution, déchets durables, destructions des espèces vivantes, etc.). Et jamais un tel imaginaire ne risquerait d’entraîner les populations de la société de l’abondance des marchandises à entrer en dissidence pour une société alternative.
Comprenons que le point crucial est ici la liberté. C’est bien notre liberté proprement humaine qui s’exprime dans notre promotion de la décroissance : nous refusons notre infantilisation comme travailleur-consommateur, nous revendiquons un autre sens à notre vie. Mais quand cette liberté se complaît dans le bénéfice affectif de son refus en contemplant son audace dans le mot qui la signifie, elle est une liberté inachevée. Elle n’a rien créé comme possibilités nouvelles de vie sociale. Pour ce faire il faudra qu’elle sorte de la subjectivité stérile de l’imaginaire d’une « société sans » pour trouver la voie de la verbalisation avec autrui, du dialogue, afin de parvenir à un discours cohérent établissant un projet commun. Hannah Arendt a montré que nous ne réalisons pleinement notre liberté humaine que dans l’action politique « car l'action et la politique, parmi toutes les capacités et possibilités de la vie humaine, sont les seules choses dont nous ne pourrions même pas avoir l'idée sans présumer au moins que la liberté existe, et nous ne pouvons toucher une seule question politique sans mettre le doigt sur une question où la liberté humaine est en jeu » (La crise de la culture). L’« action », pas la « réaction » ! Et l’action politique requiert le passage de l’émotion collective qui nous fait nous reconnaître affectés de concert par une condition sociale inacceptable, à la réflexion collective qui amène à concevoir au moyen du discours rationnel une autre société possible et souhaitable[2]. Cela signifie que la décroissance n’est pas encore une notion politique et qu’elle est à contre-emploi comme principe d’une démarche politique.
C’est bien ce que paraissent illustrer les essais d’élaboration rationnelle d’une voie vers une société alternative désirable qui sont proposés aujourd’hui et qui se rangent sous le principe de la décroissance comme si cela ne pouvait aller que de soi (voir par exemple les essais de P. Rabhi, S. Latouche, J.-P. Besset, P. Viveret, etc.). Ces penseurs, quoiqu’ils en veuillent (ils font de touchants efforts pour positiver), sont pris dans les filets de l’apriori négatif de leur démarche. Ils sont en effet constamment confrontés au problème des limites. Où placer les limites des transformations humaines de la nature pour créer des biens ? Comment les légitimer ? Comment éviter de faire appel à une instance transcendante reconductrice de croyances ? Comment échapper à l’instauration d’un moralisme écologiste au moins pesant sinon totalitaire ? Ces auteurs résolvent ces problèmes en pariant sur une régulation immanente, c’est-à-dire qui tendrait à se faire d’elle-même par la redécouverte par chacun de ses intérêts proprement humains (donc non infantiles et de caractère non addictif). Ils la cherchent en général à la fois du côté de la récompense par les sentiments – « sobriété heureuse » – et du côté de la sagesse populaire telle qu’elle se manifeste dans les diverses initiatives locales de solutions de vie fondées sur des principes alternatifs (comme en montre le film « Demain ») et qui représenteraient chacune ce que l’on se plaît nommer une « utopie concrète ».
Mais d’« utopie concrète », il n’y aura jamais. C’est une contradiction dans les termes puisque, étymologiquement, « utopie » est la description d’une société idéale qui ne peut exister nulle part. Il y a effectivement des tentatives – il faudrait dire des « créations » – concrètes de vie sociale alternative qui durent et réussissent plus ou moins. Elles sont un puissant espoir, non pas parce qu’elles seraient comme des « utopies »[3] , mais parce que ce sont des « expériences », certes faillibles, mais pour cela toujours riches d’enseignements. La réflexion collective à partir de ces expériences peut effectivement permettre de préciser les contours d’une société alternative souhaitable (c’est là seulement que la notion d’« utopie » peut se justifier), et la voie qui peut y mener. Quant à l’annonce de la joie par la sobriété (« sobriété heureuse »), il faut accepter que l’idiosyncrasie du sage qu’elle préfigure ne soit pas universalisable et que ceux qui contreviendraient ne soient pas socialement dangereux. Rappelons à ce propos les dernières lignes de l’Éthique de Spinoza : « La Béatitude n’est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même ; et nous n’en jouissons pas parce que nous réprimons nos penchants, mais c’est au contraire parce que nous en jouissons, que nous pouvons réprimer nos penchants. »
Ainsi, il apparaît que, dans la théorisation contemporaine d’une société alternative à notre si dévastatrice société mercatocratique, l’apriori accordé à la décroissance amène à une inversion dans l’ordre des raisons. On veut voir le bonheur surgir de la sobriété, alors que ce serait plutôt dans un état social en lequel on serait bien parce qu’il serait conforme à notre humanité qu’on n’aurait plus de raisons de poursuivre indéfiniment à travers des actes de consommation un bien qu’ils ne sauraient apporter. De même on veut voir des « utopies » déjà réalisées et qu’il suffirait de généraliser dans les expériences locales alternatives – « utopie » signifiant alors « îlot de décroissance » –, bien qu’il ne s’agisse que d’essais d’autres principes de vie sociale qui doivent être confrontés, critiqués, élaborés. L’utopie ne saurait venir qu’au bout de cette démarche théorique collective. Et il faut rappeler ici, après les errements des continuateurs de Marx, que l’utopie n’est jamais la description d’une société à concrétiser, mais la clarification du sens à donner à une action politique « révolutionnaire » (au sens propre : qui vise à changer les principes de la vie sociale).
L’enjeu, c’est de nous atteler positivement à une construction de l’avenir. Cela suppose que nous ayons acquis suffisamment de lucidité sur les démons qui ont obéré notre passé – et il n’y a pas que l’infantilité de notre rapport au travail et à la marchandise[4] – pour ne pas nous abîmer dans des règlements de compte avec eux. Nous pouvons nous rattacher aux espoirs et réflexions de nos mères et pères à l’orée de la révolution industrielle quand, se rendant compte des lourds nuages sur l’humanité qu’annonçaient les projets d’instauration du règne de la marchandise et de l’argent par les « bourgeois » nouvellement arrivés au pouvoir, ils s’y sont opposés avec leur corps, dans de nombreux mouvements populaires entre 1789 et 1871, mais aussi avec leur esprit en proposant une logique alternative des rapport sociaux[5].
Aujourd’hui, il nous faut prendre en compte, non seulement l’injustice sociale créée par l'empire de la marchandise, mais la crise écologique aigüe en laquelle il plonge la planète. Une bonne entrée pour une réflexion tirant parti des expériences alternatives locales ne serait-elle pas dans la question : quel sens est-il souhaitable de donner à notre activité de transformation de l’environnement naturel ?
[1] Voir notre article Du grand silence de l’économie bavarde.
[2] Un facteur qui rend difficile la claire conscience d’une démarche politique féconde est la dévalorisation culturelle contemporaine de la raison dont la reconnaissance de la valeur pour la liberté semble emportée avec l’eau du bain de la condamnation du progrès technoscientifique.
[3] On retrouve le caractère réactif de l’investissement dans le désir de les idéaliser, voire de les canoniser, à tout prix.
[4] Voir en particulier La technique comme symptôme d'un rapport passionnel à la nature tiré de notre ouvrage « Pourquoi l'homme épuise-t-il sa planète ? » .
[5] Il nous semble significatif que le film "Demain" ait oublié la plus consistante des mises en pratique de solutions alternatives : celle constituée par le journal français Le Canard enchaîné. Cet hebdomadaire, paraissant depuis plus d'un siècle, est directement issu de ce socialisme coopératif, solidaire et un brin anar qui, au long du XIX° siècle, s'est voulu une alternative à l'industrialisation. Le Canard enchaîné n'a jamais accepté de publicité, n'a pas augmenté son prix de vente depuis 1991, et pourtant échappe totalement à la crise actuelle de la presse écrite, tout en faisant un travail d'enquête sur la vie sociale, et de satire des pouvoirs en place, salutaires pour l'intérêt public. Dans la quête des solutions alternatives, n'aurions-nous pas besoin d'un peu plus de mémoire ? Ne serait-ce pas son déficit qui nous laisserait glisser vers les impasses de la décroissance ?